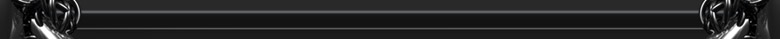I_
QUE SIGNIFIE LE TERME "ACIDE"
ET "PH"
Un acide est une
substance au goût aigre, qui se caractérise chimiquement par sa capacité à
réagir avec une base pour former un sel. Le papier tournesol bleu (ou papier
pH) devient rouge lorsqu'il est trempé dans un acide. Les acides forts brûlent
la peau.
Le pH est une échelle
logarithmique qui mesure la quantité d'acide dans un liquide comme l'eau. Étant
donné que les acides libèrent des ions d'hydrogène, la teneur en acide d'une
solution dépend de la concentration des ions hydrogène, ce qui est exprimée par
une valeur de pH. Cette échelle est aussi appliquée à la mesure de l'acidité
des échantillons de précipitations.

- 0 = acidité maximale
- 7 = point neutre
- 14 = basicité maximale (le
contraire de l'acidité)
Plus le chiffre est petit sur l'échelle de pH,
plus la substance est acide. Les précipitations dont le pH est
compris entre 0 et 5 sont acides, d'où la désignation de
« précipitations acides ». À de petites variations de pH
correspondent de grands changements d'acidité.
Par exemple, un
changement d'une seule unité de pH (disons de 6,0 à 5,0) indique une
augmentation de l'acidité par un facteur de 10. Les précipitations non
polluées ont ordinairement un pH de 5,6. Elles sont légèrement acides à
cause du dioxyde de carbone naturellement présent dans l'atmosphère. En
comparaison, mentionnons que le pH du vinaigre est de 3.

II_
QUEL EST L'ORIGINE DES PLUIES
ACIDES
Le terme général « dépôts
acides » ne désigne pas simplement les précipitations acides. Les dépôts acides
proviennent principalement de la transformation du dioxyde de soufre (SO2)
et des oxydes d'azote (NOx) en polluants secondaires secs ou humides comme
l'acide sulfurique (H2SO4), le nitrate d'ammonium (NH4NO3)
et l'acide nitrique (HNO3). Le SO2 et les NOx se transforment
en particules et en vapeurs acides lorsque ces substances sont transportées
dans l'atmosphère sur de longues distances pouvant varier de centaines à des
milliers de kilomètres. Les particules et les vapeurs acides peuvent se déposer
de deux façons : par voie humide ou par voie sèche. Les dépôts humides sont les
précipitations acides, à savoir le phénomène qui survient lorsque les acides,
dont le pH est normalement inférieur à 5,6, tombent de l'atmosphère sous forme
de pluie, de neige, de giboulée et de grêle. Les dépôts secs se produisent
quand des particules comme les cendres volantes, les sulfates, les nitrates et
les gaz (le SO2 et les NOx, par exemple) se déposent sur les
surfaces ou y sont absorbées. Les gaz peuvent alors être transformés en acides
au contact de l'eau.

III_ FORMATION DES PLUIES
ACIDES
Les pluies acides peuvent être
causées par deux différents produits :
- le monoxyde d’azote (NO)
-
le dioxyde de soufre (SO2)
Deux réactions se produisent alors sur le plan chimique :
¤ pour NO :
2
NO + O2 à 2 NO2
3
NO2 + H2O à 2 HNO3 +
NO
¤ pour SO2 :
2
SO2 + O2 à 2 SO3
SO3 + H2O à H2SO4
Les deux
molécules réagissent au contact du dioxygène de l’air et le produit formé se
dissout dans l’eau de l’air.
Les deux molécules d’origine proviennent des rejets des machines
modernes. Le monoxyde d’azote provient des gaz d’échappement. Le dioxyde de
soufre provient de la combustion des carburants fossiles (qui contiennent du
soufre).
En outre, le dioxyde de carbone ( CO2 )
contenu dans l’air à cause de la pollution acidifie un peu l’eau des nuages.
Les gaz volcaniques et les aérosols sont aussi acides et donc peuvent causer
des pluies acides.
Un exemple record de pluie acide aux Etats-Unis : les
précipitations ont atteint un pH de 1 ,5 !
En
conclusion, nous pouvons dire
que l'industrialisation du pays
joue un role dans la formation
des pluies acides, surtout quans
certaines mesures ne sont pas
respectées.


IV_
OU LES PRECIPITATIONS ACIDES
POSENT-ELLES UN PROBLEME
Elles constituent un
problème dans l'est du Canada parce que bon nombre des systèmes aquatiques et
terrestres de cette région ne sont pas suffisamment alcalins (pas assez
calcaires) et qu'ils ne parviennent pas à neutraliser naturellement les
précipitations acides. Les provinces du Bouclier canadien précambrien, comme
l'Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick et la Nouvelle-Écosse, sont frappées le plus durement parce que
leurs systèmes aquatiques et terrestres ne parviennent pas à contrer les effets
néfastes des précipitations acides. De fait, plus de la moitié de la superficie
du Canada repose sur un substratum granitique dur qui ne peut pas bien
neutraliser les pluies acides. Si ces systèmes étaient plus alcalins, comme
c'est le cas dans certaines parties de l'ouest du Canada et du sud-est de
l'Ontario, ils parviendraient à neutraliser naturellement les précipitations
acides, ce qu'on appelle l'effet-tampon.
Les données sur l'ouest
du Canada sont insuffisantes et ne permettent donc pas actuellement de
déterminer si les précipitations acides perturbent les écosystèmes. Dans le
passé, des facteurs comme l'industrialisation moins intense, contrairement à la
situation dans les provinces de l'est, et des facteurs naturels comme les vents
dominants, qui soufflent d'ouest en est, ainsi que des sols plus résistants (et
donc plus en mesure de neutraliser l'acidité) ont soustrait la majeure partie
de l'ouest canadien aux ravages des précipitations acides.
Cependant, des secteurs
de l'ouest canadien ne sont pas à l'abri de cette pollution. Par exemple, les
lacs et les sols reposant sur un substratum granitique ne sont pas en mesure de
neutraliser l'acidité. C'est le cas, par exemple, dans certaines parties du
Bouclier canadien situées dans le nord-est de l'Alberta, dans le nord de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que dans certaines
parties de la Colombie-Britannique, dans le Nunavut et dans
les Territoires du Nord Est. Les lacs de ces secteurs n'ont pas plus de moyens
de défense contre les précipitations acides que ceux du nord de l'Ontario. Si
les émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote continuent d'augmenter
dans l'ouest du pays, on y observera les mêmes incidences nuisibles qui se
produisent dans l'est.
Visitez le site Web de la Région de l'Atlantique pour obtenir de plus amples
renseignements sur les pluies acides dans cette région.
Pour savoir comment
obtenir des données ou des cartes relatives au dépôt acide, visitez le site Web
de NatChem.

V_
D'OU VIENNENT LES EMISSIONS
DE DIOXYDE DE SOUFFRE (SO2)
? CES EMISSIONS ONT-ELLES CHANGEES
?
Le
dioxyde de soufre (SO2) est normalement un sous-produit de procédés
industriels et de la combustion de combustibles fossiles. La première fusion de
minerais, l'exploitation de centrales au charbon et le traitement du gaz
naturel sont les principales sources de SO2.
En 2000, par exemple, les
émissions de SO2 aux États-Unis se sont chiffrées à 14,8 millions de
tonnes, soit plus de 6 fois les émissions canadiennes, qui atteignaient 2,4
millions de tonnes au total. Mais les sources d'émissions diffèrent d'un pays à
l'autre. Au Canada, 68 % des émissions proviennent des sources industrielles et
27 % des services publics d'électricité (2000). Aux États-Unis, elles
proviennent à 67 % des services publics d'électricité (2002).
Le Canada ne parviendra
pas seul à vaincre le problème des précipitations acides. En effet, la
réduction des émissions doit s'obtenir de part et d'autre de la frontière. Plus
de la moitié des dépôts acides dans l'est du Canada proviennent d'émissions aux
États-Unis. Environ les trois-quarts du dépôt que reçoivent des régions comme
le sud-est de l'Ontario (Longwoods) et Sutton, au Québec, sont d'origine
américaine. En 1995, on a estimé entre 3,5 et 4,2 millions de tonnes par an le
passage transfrontière du dioxyde de soufre.

Émissions de SO2 du Canada et
des États-Unis
En vertu du Programme de
lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada, qui a été lancé en 1985,
le Canada s'engageait à limiter à 2,3 millions de tonnes ses émissions de SO2
dans les sept provinces de l'est en partant du Manitoba pour 1994, ce qui
représentait une réduction de 40 p 100 par rapport aux valeurs de 1980. En
1994, les sept provinces avaient atteint ou dépassé leurs objectifs. En 1998,
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada ont signé la StratégiE pancanadienne sur les émissions acidifiantes
après l'an 2000 en vertu de laquelle ils s'engageaient à prendre des mesures
supplémentaires pour réduire les pluies acides. Les progrès réalisés dans le
cadre du Programme de lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada et de
la Stratégie pancanadienne sur les
émissions acidifiantes après l'an 2000, y compris des données relatives aux
émissions sont présentés dans les rapports annuels respectifs de ces derniers.
De 1980 à 2001, les émissions de SO2 ont diminué d'environ 50 % pour
se situer à 2,38 millions de tonnes. Dans l'est du Canada, elles ont diminué
d'environ 63 % pendant cette même période.

VI_
D'OU PROVIENNENT LES EMISSIONS
DE NOx ?
La
combustion des carburants pour véhicules automobiles et des combustibles pour
les appareils de chauffage résidentiels et commerciaux, pour les moteurs et les
chaudières industriels et pour l'alimentation des centrales électriques et
d'autre matériel constitue la principale source d'émissions de NOx. En 2000, le
secteur du transport était la source la plus importante de NOx au Canada; il
prenait une part d'environ 60 % de toutes les émissions. Au total, celles-ci se
sont chiffrées à 2,5 millions de tonnes cette année-là. Aux États-Unis, elles
avaient atteint 21 millions de tonnes, soit huit fois plus qu'au Canada.
Le transport
transfrontière des polluants atmosphériques des États-Unis vers le Canada a une
influence marquée. Environ 24 % des épisodes d'ozone d'échelle régionale
observés aux États-Unis aussi affectent l'Ontario. L'analyse de la
concentration de l'ozone à quatre emplacements dans la pointe extrême du
sud-ouest ontarien, qui tient compte de l'orientation et de la force des vents,
permet d'estimer qu'entre 50 % et 60 % de l'ozone qui y est mesuré provient des
États-Unis (équipe du Programme scientifique sur les NOx et les COV, 1997b).
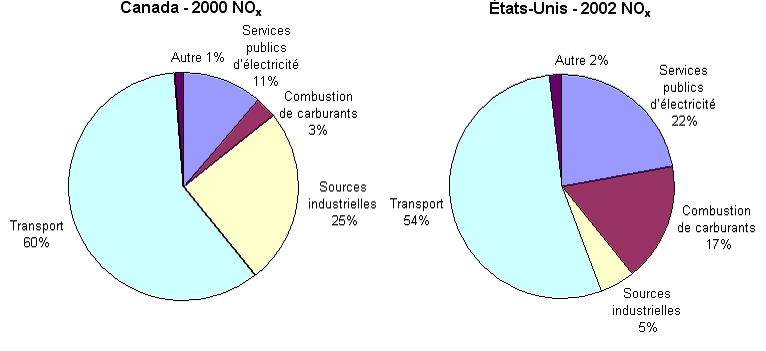
Émissions de NOx du Canada et
des États-Unis
Au Canada, les
émissions totales de NOx sont relativement stables depuis 1985. Depuis 2000, on
y a réduit les sources fixes d'émissions de NOx de plus de 100 000 tonnes par
rapport au niveau prévu pour les centrales électriques, les principales sources
de combustion et les fonderies. En 2000, en vertu des dispositions de l'Annexe
sur l'ozone à l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air, le Canada s'est engagé
à limiter les émissions de NO2 des centrales à combustible fossile à
39 000 tonnes dans le centre et le sud de l'Ontario et à 5 000 tonnes dans le
sud du Québec. Il s'est aussi engagé à imposer des normes plus rigoureuses de
réduction des émissions provenant de la combustion des carburants pour
véhicules automobiles et à prendre des mesures pour réduire les émissions de
NOx des chaudières industrielles. Selon les estimations, ces engagements
devraient permettre d'atteindre en 2010 une réduction d'environ 39% des
émissions annuelles de NOx de 1990 dans la région transfrontière canadienne
(soit le centre et le sud de l'Ontario et le sud du Québec).

VII_
QUELLES EST LA DIFFERENCE ENTRE
UNE CHARGE CIBLE ET UNE CHARGE
CRITIQUE
La charge
critique
est une mesure du degré de pollution qu'un écosystème peut tolérer. En d'autres
mots, c'est le palier au-delà duquel le milieu est endommagé. La charge
critique varie selon les régions. Les écosystèmes tolérants aux précipitations
acides ont une charge critique élevée, les écosystèmes vulnérables ont une
faible charge critique.
Au Canada, la charge
critique varie d'une région à l'autre. Elle dépend de la capacité d'un
écosystème donné de neutraliser l'acidité. Pour les écosystèmes aquatiques, les
scientifiques l'ont défini comme étant la quantité de dépôts humides de sulfate
en dessous de laquelle 95 % des lacs sont protégés contre l'acidification
jusqu'à un pH inférieur à 6. (Le point de neutralité est le pH 7; toute valeur
inférieure est dans la plage acide, toute valeur supérieure est dans la plage
basique). À un pH inférieur à 6, les poissons et d'autres espèces aquatiques
entament leur déclin.
Une charge cible est un
niveau de pollution pouvant être respecté et que l'on considère comme étant
politiquement acceptable lorsque d'autres facteurs (p. ex., facteurs d'ordre
éthique, incertitudes scientifiques et incidences socio-économiques) sont
examinés en regard des considérations d'ordre environnemental. En vertu du
Programme de lutte contre les pluies acides dans l'est du Canada, le Canada
s'était engagé à limiter à 2,3 millions de tonnes ses émissions de SO2
dans les sept provinces de l'est en partant du Manitoba pour 1994. Ce programme
avait pour objectif de réduire les dépôts humides de sulfate à une valeur cible
de 20 kg, au plus, par hectare et
par an (kg/ha/an). Nos scientifiques avaient alors estimé que ce taux de dépôt
était acceptable pour protéger les écosystèmes aquatiques modérément
vulnérables à l'acidification.
Dans le cadre de la Stratégie
pancanadienne sur les émissions acidifiantes après l'an 2000, signée en 1998, les
gouvernements fédéral et provinciaux du Canada ont convenu d'adopter comme
principal objectif à long terme, de respecter les charges critiques pour le
dépôt acide à l'échelle du pays. Récemment, on a conçu des cartes qui combinent
des valeurs de charges critiques pour les écosystèmes aquatiques et forestiers.
Ces cartes indiquent la quantité d'acidité (exprimée en équivalents par hectare
et par an (éq/ha/an) que la partie la plus vulnérable de l'écosystème d'une
région déterminée peut recevoir sans subir de dégâts.

Cliquez pour
agrandir
La charge critique est la quantité maximum de dépôts acides qu'une
région donnée peut recevoir sans que les écosystèmes subissent de dommages.
Elle dépend essentiellement du pouvoir de neutralisation des acides des eaux,
des roches et des sols et, comme l'indique cette carte du Canada, elle peut
varier considérablement d'une région à une autre. On a calculé les charges
critiques en utilisant les modèles de chimie de l'eau (« expert » ou « SSWC »)
ou un modèle du sol forestier (« SMB »). La carte répertoire (en bas à gauche)
indique le modèle sélectionné pour chaque carré de grille : rouge = expert
(aquatique), jaune = SSWC (aquatique), vert = SMB (sols forestiers secs).

VIII_
LES PLUIES ACIDES CONTINUERONT-ELLES
DE SUSCITER DES PREOCCUPATIONS
SI L'ON NE PREND PAS DE MESURES
DE LUTTE SUPPLEMENTAIRES
Oui. Dès 1990, les
scientifiques estimaient, tant au Canada qu'aux États Unis, qu'il fallait
accroître d'environ 75 % les réductions des émissions de SO2
auxquelles se sont engagés les deux pays en vertu de l'Accord sur la qualité de
l'air de 1991 afin de résoudre la question des dépôts acides au Canada. Cette
prévision se fondait sur les effets des acides dérivés du soufre dans les
dépôts humides sur les écosystèmes aquatiques. L'Évaluation scientifique 2004
des dépôts acides au Canada examine des données nouvelles pour déterminer dans
quelle mesure les écosystèmes aquatiques et terrestres peuvent absorber les
acides dérivés à la fois du soufre et de l'azote présents dans les dépôts secs
et humides. D'après les estimations améliorées des dépôts secs (soit le total
des dépôts de SO2 gazeux, de particules de sulfate, d'acide
nitrique, de particules de nitrate et d'autres espèces azotées), les charges
critiques ont été surestimées dans le passé, ce qui laisse supposer que les
prévisions antérieures concernant les incidences des stratégies de lutte
proposées étaient exagérément optimistes. Dans certaines régions, les charges
critiques des écosystèmes forestiers sont plus rigoureuses même que celles des
écosystèmes aquatiques. Vu les nouvelles charges critiques des écosystèmes
terrestres, le Canada doit évaluer la viabilité des écosystèmes forestiers en
fonction de divers niveaux de dépôts acides. Les données améliorées
continueront sans doute de mettre en évidence la nécessité de réaliser des
réductions des émissions de SO2 aussi considérables ou sensiblement
plus importantes.
C'est
pourquoi la Stratégie pancanadienne sur les
émissions acidifiantes après l'an 2000 demande des réductions supplémentaires
tant au Canada qu'aux États-Unis. Si aucune mesure de contrôle autre que celles
mentionnées dans l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air de 1991
n'est mise en place, certains secteurs du sud et du centre de l'Ontario, du sud
et du centre du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse continueraient de recevoir des quantités
moyennes annuelles de dépôts humides de sulfate supérieures à leur charge
critique. Celle-ci serait dépassée de 10 kg/ha/an par endroits dans le centre
de l'Ontario et le centre et le sud du Québec. Il s'ensuit qu'environ 95 000
lacs demeureraient endommagés par les précipitations acides. Dans ces secteurs,
les lacs ne se sont pas ajustés à la baisse des dépôts de sulfate autant ou
aussi rapidement que ceux situés dans des secteurs moins vulnérables. En fait,
certains de ces lacs ont continué de s'acidifier.
Au total, en l'absence de
mesures de contrôle supplémentaires, une superficie d'environ 800 000 km2
(soit la France et le Royaume-Uni
réunis), dans le sud-est du Canada, recevrait des quantités nocives de
précipitations acides. C'est-à-dire que ces quantités dépasseraient largement
la charge critique des systèmes aquatiques.
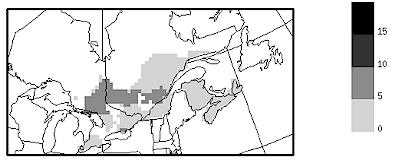
Dépassements du dépôt
humide de sulfates (en kg/ha/an) prévus pour 2010 par rapport aux charges
critiques, en l'absence d'autres mesures de réduction.
|