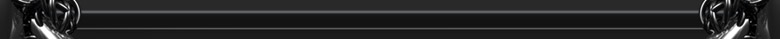La lutte contre l'effet de serre passe par la réduction des émissions des
gaz qui piègent le rayonnement solaire dans l'atmosphère, concourant au
réchauffement progressif. Mais le piégeage de ces gaz (dioxyde de
carbone, méthane, etc.) dans des « puits » naturels est aussi une
solution séduisante. La deforestation offre un moyen prometteur pour
tenter de s'approcher des engagements lors des récents sommets internationaux
sur le réchauffement climatique. Peugeot va ainsi replanter 10 millions d'arbres
dans la forêt tropicale brésilienne. Une évaluation précise du rendement
de ces reforestations est nécessaire avant que ces puits de carbone puissent
constituer une monnaie d'échange dans les négociations internationales sur les
« droits à polluer ». Une tâche qui, reconnaissent les scientifiques,
s'annonce difficile. Planter des arbres pour contrer
l'effet de serre
Peugeot va reboiser une
parcelle de la forêt brésilienne. Cette démarche rejoint celle des
scientifiques qui tentent d'évaluer l'impact des « puits de carbone »
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une solution séduisante, mais
limitée dans le temps.
I_
GESTICULATION
La
gesticulation médiatique ou prémices d'une véritable stratégie contre
l'effet de serre ? Peugeot, premier diéséliste du monde, a l'intention,
pour lutter contre le réchauffement climatique, de créer un grand « puits
de carbone », en plantant 10 millions d'arbres de vingt essences en
trois ans, dans l'Etat du Mato Grosso, au sein de la forêt tropicale humide
En fixant le dioxyde de carbone
(CO2) présent dans l'atmosphère, sur une surface représentant presque deux fois
la surface de Paris intra-muros, ces arbres devraient concourir, annonce le
constructeur, au stockage de 50 000 tonnes de carbone par an, soit
l'équivalent de 183 000 tonnes de CO2. Une bulle d'air pur face aux
2 milliards de tonnes de carbone dispersés dans l'atmosphère par la
déforestation, et aux milliards de tonnes provenant du transport qui, en
France, génère 35 % des émissions de CO2.
II_ MODÈLE DE
DÉVELOPPEMENT
En
replantant une parcelle du « poumon du globe », durement nécrosé par
la déforestation, Peugeot joue à l'envi sur les symboles et intègre à fond la
thématique du changement climatique : la pollution ne connaît pas de
frontière, la lutte doit être planétaire. Conscient des critiques que peut
susciter un tel mécénat, le constructeur prouve le sérieux de sa démarche en
investissant 65 millions de francs dans le projet.
III_ EQUILIBRE CHAMBOULÉ
Quel que soit le résultat à terme,
la démarche de l'industriel s'inscrit dans une réflexion plus large de la
communauté scientifique sur les différentes méthodes de lutte contre l'effet de
serre. Si l'on fait abstraction de l'activité humaine, on estime que la
photosynthèse globale fixe 120 milliards de tonnes de carbone par an
(GtC/an), en équilibre avec les émissions provenant de la respiration des
plantes (60 GtC/an) et des animaux. Mais l'homme, à travers la
consommation de combustibles fossiles notamment, a chamboulé cet équilibre.
Comment restocker ce
carbone de la façon la plus efficace et durable possible ? La revue Nature
vient de publier une étude américaine analysant l'impact d'une
reforestation expérimentale conduite en Caroline du Sud. Carol Wells, du
service forestier de Caroline du Nord, et ses collègues ont notamment étudié la
recolonisation d'anciens champs de coton par des résineux.
En
analysant l'évolution de la concentration en carbone 14 d'échantillons
prélevés à intervalles réguliers dans le sol de cette forêt durant les quarante
dernières années, ils ont pu déduire un profil de l'absorption du CO2. Ils ont
constaté que, dans les premiers temps, celui-ci s'accumulait rapidement dans
les 60 premiers centimètres du sol, puis que le phénomène se ralentissait.
A partir des années 90, seuls les 7,5 premiers centimètres du sol, la
litière et les arbres eux-mêmes « aspiraient » le carbone.Au total, 80 % environ
du carbone séquestré l'a été dans les arbres, 20 % dans la lisère, et
moins de 1 % dans le sol, sans doute en raison de la nature argileuse de
celui-ci, propice à la décomposition rapide des composés organiques.
A l'heure des grandes
négociations sur la lutte contre l'effet de serre ouvertes à Kyoto (1997), plus
décevantes à Buenos Aires (1998), de telles études peuvent sembler académiques.
Elles seront, pourtant, au centre des discussions futures : les
séquestrations de gaz carbonique ne sont que partiellement comptabilisées, pour
la période 2008-2012, dans les engagements de réduction d'émissions pris par
les signataires du protocole de Kyoto.
La question des puits de
CO2 dans les terres agricoles et la foresterie est encore ouverte, et les
forêts du futur pourraient constituer des monnaies d'échange dans la foire
internationale des droits à polluer.
Encore faudrait-il être
capable d'évaluer précisément quels seront les rendements de ces puits, et
effectuer une sorte de « point zéro » sur la contribution nette de
l'espace rural et forestier à l'accumulation de gaz à effet de serre.
Cette problématique a
récemment fait l'objet d'un colloque à Paris, où scientifiques, gestionnaires
et industriels ont confronté leurs points de vue.
En forêt tempérée, « le
bilan de carbone est toujours une immobilisation nette », confirme
Didier Lousteau, de l'unité de recherche forestière bordelaise de l'INRA, qui
indique que les évaluations des stocks sont difficiles : si, pour la
biomasse des arbres, le décompte est relativement aisé, celle présente dans le
sol est délicate, et, « pour une production ligneuse identique, ce
bilan peut pratiquement varier du simple au double, voire même s'inverser,
suivant l'importance des émissions de CO2 du sol ».
IV_ L'INCONNUE DES RACINES
Le bilan est d'autant plus difficile à cerner que l'éventuel
réchauffement climatique va accélérer la pousse des arbres, mais aussi la
respiration productrice de carbone, tout comme l'émission de précurseurs de
l'ozone troposphérique... Une autre boîte noire concerne les racines, dont on a
du mal à déterminer la masse. Actuellement, en Europe, le carbone est
immobilisé le plus efficacement dans des hêtraies de quatre-vingt-dix ans,
alors que les forêts de conifères suédoises du même âge environ peuvent en
émettre. Avant de planter des « puits » à tout va, il faut donc bien
connaître sols et essences, et en planifier l'exploitation.
Claude Roy, directeur de l'agriculture
et des bioénergies de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe), propose quatre scénarios permettant, selon lui, d'ici à
2010, de fixer ou d'éviter à la France de produire 16 millions de tonnes
de CO2 par an, soit presque la moitié des engagements pris à Kyoto, qui
supposent une réduction de 30 millions à 40 millions de tonnes par
an.
Ces scénarios passent par
le reboisement, l'utilisation du bois en chaufferies et comme matériau de
construction, et, côté agricole, par la production de biocarburants, de
lubrifiants et autres substituts de la filière chimique. Les coûts sont compris
entre 5 francs et 400 francs la tonne de CO2 évitée, contre
35 francs environ dans le projet de Peugeot.
Il est donc impératif de
limiter les émissions à la source. C'est l'autre pari technologique que Peugeot
et ses concurrents, qui n'ont pas vocation à replanter toute l'Amazonie,
prétendent vouloir relever, avec leurs nouvelles motorisations.
V_
L'IMPACT DE L'AGRICULTURE
Les paisibles ruminants,
avec leur estomac d'alchimiste concourent au changement climatique :
15 % à 18 % de la production du méthane terrestre - et, de ce
fait, 2 % ou 3 % de l'effet de serre - sont éructés par les animaux
d'élevage. Il faut y ajouter le méthane issu de leurs déjections (lisiers,
fumiers, fientes, composts). Des additifs alimentaires permettent une
diminution de 20 % à 30 % de ces émissions carbonées, et l'aération
du lisier peut les réduire de 70 % à 80 %.
Mais on
doit éviter que ces opérations n'occasionnent le dégazage de matières azotées,
tout aussi indésirables. L'oxyde d'azote, N2O, contribue en effet pour 5 %
à 7 % à l'effet de serre additionnel. De l'avis général, les modèles
permettant de simuler ces émissions sont encore trop sommaires. |